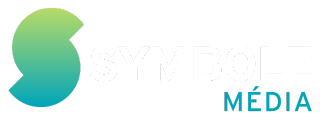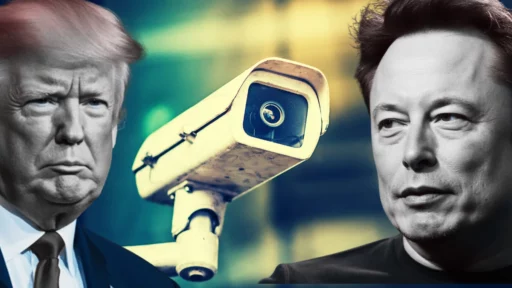Donald Trump a suspendu, pour 90 jours, les tarifs douaniers contre tous les pays… sauf la Chine. Un geste qui, loin d’être un renoncement, marque une nouvelle étape dans sa stratégie : monnayer l’accès au marché américain. Ce marché qu’on pourrait désormais qualifier de « mis aux enchères », reflète le nouveau rôle que les États-Unis veulent jouer sur la scène mondiale : les États-Unis ne veulent plus entretenir l’ordre mondial gratuitement, ils veulent le rentabiliser.
EN BREF
- Trump transforme l’accès au marché américain en monnaie d’échange stratégique.
- Les États-Unis se retirent de leur rôle de gendarme mondial.
- La Chine comble le vide mais reste fragilisée intérieurement.
- Le dollar est menacé, notamment par la pression chinoise sur la dette américaine.
- La mondialisation libérale touche à sa fin ; le protectionnisme revient.
- Trump incarne un tournant global, pas juste une parenthèse.
- Un nouvel ordre mondial, multipolaire et instable, est en train de naître.
La fin du gendarme du monde
Depuis Obama, et plus encore avec Trump évidemment, l’Amérique se retire peu à peu de ses engagements internationaux. Désintérêt pour l’OTAN, défiance envers l’OMC, repli sur soi… Maintenir l’ordre mondial coûte trop cher, militairement et économiquement.
Trump le dit et l’assume : l’Amérique n’a plus les moyens d’être l’arbitre mondial. Elle veut redevenir un acteur comme les autres, mais avec les meilleures cartes en main. Ce recul n’est pas seulement stratégique, il est culturel : les États-Unis s’interrogent sur leur propre identité, entre leadership global et nationalisme décomplexé.
La Chine en embuscade
Ce retrait progressif ouvre un vide. Et la Chine semble prête à le combler. Pour Xi Jinping, l’heure est venue de reprendre la place que l’Occident lui a volée depuis le Traité de Nankin qui mit fin à la première guerre de l’opium, en 1842.
La Chine est stratégique et patiente : elle parie sur l’affaiblissement progressif de l’Occident pour étendre son influence à long terme. Plus l’Amérique se replie, plus la Chine s’étend — dans les routes de la soie, les alliances commerciales, les technologies stratégiques.
Mais l’empire du Milieu joue une course contre la montre : surcapacité industrielle, consommation atone due à une monnaie volontairement faible, mais surtout un vieillissement démographique massif pourraient enrayer son ascension si elle attend trop longtemps.
Le dollar n’est plus invincible
L’une des conséquences inattendues de la stratégie de Trump est la fragilisation de la confiance mondiale dans le dollar. En isolant les États-Unis et en déstabilisant les marchés par des annonces brutales, Trump expose la monnaie américaine à une remise en cause.
La Chine, notamment, mise sur un affaiblissement de la domination du dollar pour promouvoir une refonte monétaire mondiale. Le réseau d’alliances et de confiance qui soutenait le dollar comme monnaie de référence s’effrite.
Surtout, la Chine détient une arme silencieuse mais redoutable : ses réserves massives de bons du Trésor américain. Si Pékin décidait de les vendre massivement, elle provoquerait une hausse des taux d’intérêt américains, une déstabilisation du marché obligataire et une perte de crédibilité du dollar. Un tel scénario — que certains surnomment déjà un « Pearl Harbor monétaire« — n’est pas encore enclenché, mais la menace inquiète Wall Street comme Washington.
Car les États-Unis jouent ici l’un de leurs principaux leviers de puissance. Le dollar a longtemps été le pilier invisible de l’ordre mondial. S’il vacille, c’est tout l’échafaudage qui tremble.
La fin d’une parenthèse : celle de la mondialisation débridée
Entre 1989 (chute du mur de Berlin) et 2022 (invasion de l’Ukraine), le monde a connu un moment unique : un ordre global sans rival, dominé par les États-Unis. Une période de libre-échange intense, de dérégulation, de circulation sans entraves.
Cette période s’achève. Retour des risques géopolitiques, réarmement industriel, tensions commerciales : l’ordre mondial se recompose. Les entreprises réorientent leurs chaînes d’approvisionnement, les États parlent de relocalisation, et les opinions publiques défient la mondialisation perçue comme injuste. Le climat de confiance s’efface au profit d’une logique de précaution.
Trump : symptôme ou stratège ?
Trump n’est peut-être que la caricature d’un mouvement plus vaste, le symptôme d’une tendance de fond : le retour de la nation, des frontières, de la protection. Il incarne une méfiance envers les élites globalisées et une volonté de restaurer la puissance industrielle perdue. Il agit brutalement, mais il capte un élan profond de l’opinion.
Ce qu’il a amorcé sera probablement poursuivi par d’autres, plus modérés mais tout aussi déterminés. En cela, Trump est moins une anomalie qu’un accélérateur. Il a mis des mots sur un malaise ancien, lié à la désindustrialisation, à l’insécurité culturelle et à la peur du déclassement.
Une nouvelle ère se dessine
Ce que nous observons n’est pas une simple crise passagère ou un accident de parcours. C’est un basculement systémique. L’ordre né de la fin de la guerre froide, fondé sur l’hyperpuissance américaine, le libre-échange et la globalisation heureuse, est en train de céder la place à un monde nouveau.
- Un monde où les nations cherchent à reprendre le contrôle de leurs industries, de leurs frontières, de leur monnaie.
- Où la souveraineté économique redevient un objectif stratégique.
- Où les grandes puissances s’affrontent non plus seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur les marchés, dans les laboratoires, dans les données.
Ce monde-là sera plus conflictuel, plus fragmenté, et probablement moins prévisible. Il ressemblera davantage aux siècles passés qu’aux trente dernières années. C’est un retour du politique dans l’économie, du territoire dans la mondialisation, du rapport de force dans la coopération. Un monde où l’Occident ne sera peut-être plus en position dominante et où l’instabilité est la nouvelle norme.
Ce qu’il faut retenir
- L’Amérique vend désormais l’accès à son marché, comme un bien stratégique.
- Le retrait américain ouvre la voie à la Chine, mais cette dernière est vulnérable.
- Le dollar, pilier du système mondial, est fragilisé.
- La mondialisation libérale touche à sa fin.
- Trump incarne une tendance de fond, plus qu’il ne la crée.
- Nous entrons dans une ère multipolaire, instable, post-occidentale.
Dans quelques années, cette phase de mondialisation avancée pourrait nous sembler aussi étrange que l’était le rideau de fer à la génération précédente. Un nouveau monde s’annonce. Il est moins ouvert, plus brutal, et surtout, il est déjà en marche.